DU STOÏCISME COMME PHILOSOPHIE DE LA FÉLICITÉ

Dans La citadelle intérieure, Hadot affirme que la discipline des désirs permet d’éviter les mauvaises passions, de se libérer de ce qui ne dépend pas de nous en se concentrant sur ce qui en dépend, distinction que l’on retrouve dans le Manuel et les Entretiens d’Épictète ; la prise de conscience consiste en ce que le bonheur, qui conduit à l’ataraxie (ce qu’Hadot nomme la « sérénité », l’état de tranquillité de l’âme), dépend de nous et non pas des biens extérieurs ou même d’autrui, élément propre à l’éthique du stoïcisme impérial romain, repris par le stoïcisme moderne. Dans ses Essais, Montaigne affirme qu’une vision stoïcienne du monde doit conduire au bonheur car elle permet d’acquérir la faculté de résistance face à l’adversité, face à la douleur, qui sert à se rendre libre ; la liberté est ici entendue comme intérieure et comme synonyme de bonheur.
Le stoïcisme permet ainsi de comprendre que la liberté dépend de nous, et que la seule manière de la conquérir est d’appliquer la vertu à son quotidien par un effort constant sur soi de conversion de son âme afin de prétendre, peut-être un jour, à la sagesse qu’on peut atteindre, par exemple, par des « exercices spirituels », selon Hadot. À cet égard, Lenoir, dans Du bonheur ou voyage philosophique, présente le stoïcisme comme une religion en établissant un lien de parenté entre cette doctrine philosophique et le bouddhisme, les deux consistant en un exercice d’ascèse. En se faisant progressant, l’homme accéderait à une strate spirituelle de son existence qui lui permettrait d’accorder sa propre nature à la Nature, ses propres désirs aux désirs de Dieu ou du Destin (équivalence montrée par Diogène Laërce dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres), ce qui l’empêcherait d’être à jamais malheureux, et lui permettrait donc d’être toujours plus dans la joie que l’insensé.
En effet, en imaginant que le progressant parvienne à un état de sagesse, ce dernier ne pourrait plus jamais être triste, comme le souligne Sénèque dans De la providence, lors de la mort d’un proche, par exemple, car il prendrait conscience qu’il s’agit là de la volonté de la Nature, qui est aussi la sienne ; il serait à l’abri de l’injustice, des insultes et de la peur, comme le mentionne Sénèque dans De la constance du sage, en ne voulant que le bien, principe énoncé par Valéry Laurand dans Le vocabulaire des Stoïciens.
De même, il serait à l’abri de la souffrance liée à la maladie ou aux tourments de l’âme qui ne dépendent pas de lui ; dans cette perspective, nous pouvons lire la prose de Guibert dans A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie :
Mancini s’était fait enterrer avec son pinceau et le Manuel d’Epictète, qui se trouve à la suite des Pensées de Marc-Aurèle, dans l’exemplaire jaune Garnier-Flammarion que Muzil avait délogé de sa bibliothèque, couvert d’un papier cristal, quelques mois avant sa mort, pour me le donner comme étant l’un de ses livres préférés, et m’en recommander la lecture, afin de m’apaiser à une époque où j’étais particulièrement agité et insomniaque
Par-delà l’apaisement du lecteur d’Épictète qu’était Foucault, alias Muzil sous la plume de Guibert, le sage voudrait tout ce qui lui arrive, y compris l’éternel retour nietzschéen (Le Gai Savoir) détourné de celui conçu par Chrysippe : il serait même capable de vouloir que sa vie se répète éternellement telle qu’elle est actuellement car il y est heureux.
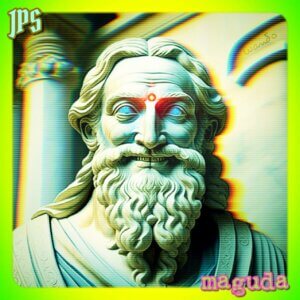
@ILLUS. by, 2023







