DE LA NÉCESSITÉ DU TRAVAIL

Dans son Traité sur la pédagogie, Kant souligne l’importance capitale de travailler afin de vivre. L’homme doit travailler pour vivre, pour s’accomplir dans sa nature, pour survivre même ; par survivance via le travail, on entend ici que sans le travail, l’homme est voué à l’ennui, qui est le pire des maux.
Le travail permet de former l’homme, de le cultiver, au sens fort du terme. De plus, le travail donne un sens à la vie. Le travail permettrait dès lors, si on fait un parallèle avec la philosophie de Cioran, de ne pas se tuer. Dans ses Pensées étranglées, Cioran met en avant que
Vivre est une impossibilité dont je n’ai cessé de prendre conscience, jour après jour, pendant, disons, quarante ans… ;
la faculté de l’homme à travailler, qui lui permet de réaliser son excellence propre, serait ce que l’on pourrait nommer, bien que Kant ne le fasse pas, « le moyen en vue de la vie », c’est-à-dire ce qui fait que l’homme ne succombe pas au désespoir que susciterait l’ennui, la déchéance de l’âme livrée à elle-même. Bien que Kant ne l’écrive pas ainsi, la réalisation du travail serait dès lors à considérer comme un affranchissement de la crise existentielle que suscite l’ennui. Sans le travail, l’homme serait à considérer comme un œuf vide qui aurait besoin d’être rempli, d’être paré par le bijou du travail afin de briller :
L’homme doit être occupé de telle manière qu’il soit rempli par le but qu’il a devant les yeux.
Kant ajoute « si bien qu’il ne se sente plus lui-même et que le meilleur repos soit pour lui celui qui suit le travail » ; le repos serait donc à considérer comme un plaisir qui ne peut pas être apprécié sans ressentir le labeur qu’est le travail. Il doit permettre à l’homme de triompher de l’ennui en donnant un sens à son existence.
Toutefois, on ne peut pas non plus considérer le travail comme un simple exutoire face à la douleur de l’ennui ou « l’impossibilité de vivre » de Cioran ; non, le travail, pour être pleinement travail, doit être lié à une activité de création, qui serait une création de soi en même temps que la création d’une chose en dehors de soi. Dans le Portrait d’un homme heureux, Erik Orsenna souligne qu’André Le Nôtre (1613-1700) s’émerveilla en plaçant dans le jardin de Versailles les proportions mathématiques qu’il avait découvertes :
Elevé dans la douceur de la perspective, Le Nôtre n’ignore rien de ces savoirs millénaires. Toujours au fait des sciences et techniques de son temps, vivant entouré d’ingénieurs, il intègre dans son œuvre les dernières découvertes, notamment l’arithmétique des suites qui gouverne le progrès des grandeurs.
Ainsi, Le Nôtre fut un homme qui allia passion de la découverte et du progrès au labeur, qui maria l’émerveillement à un travail à la fois accompli et innovant à la rudesse de sa discipline.
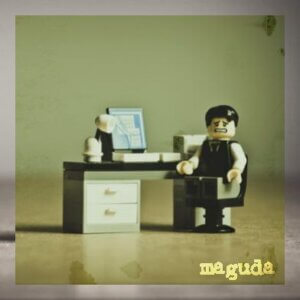
@ILLUS. by MAGUDA, 2023







